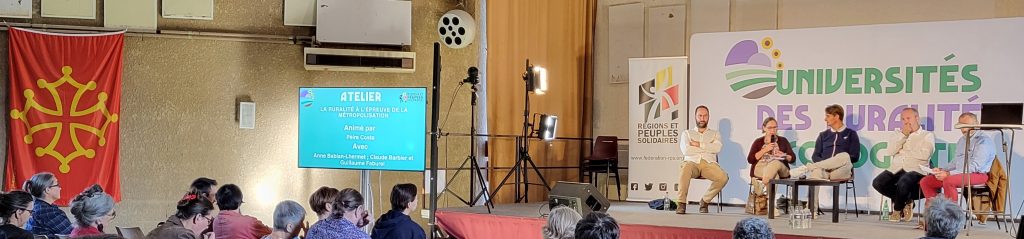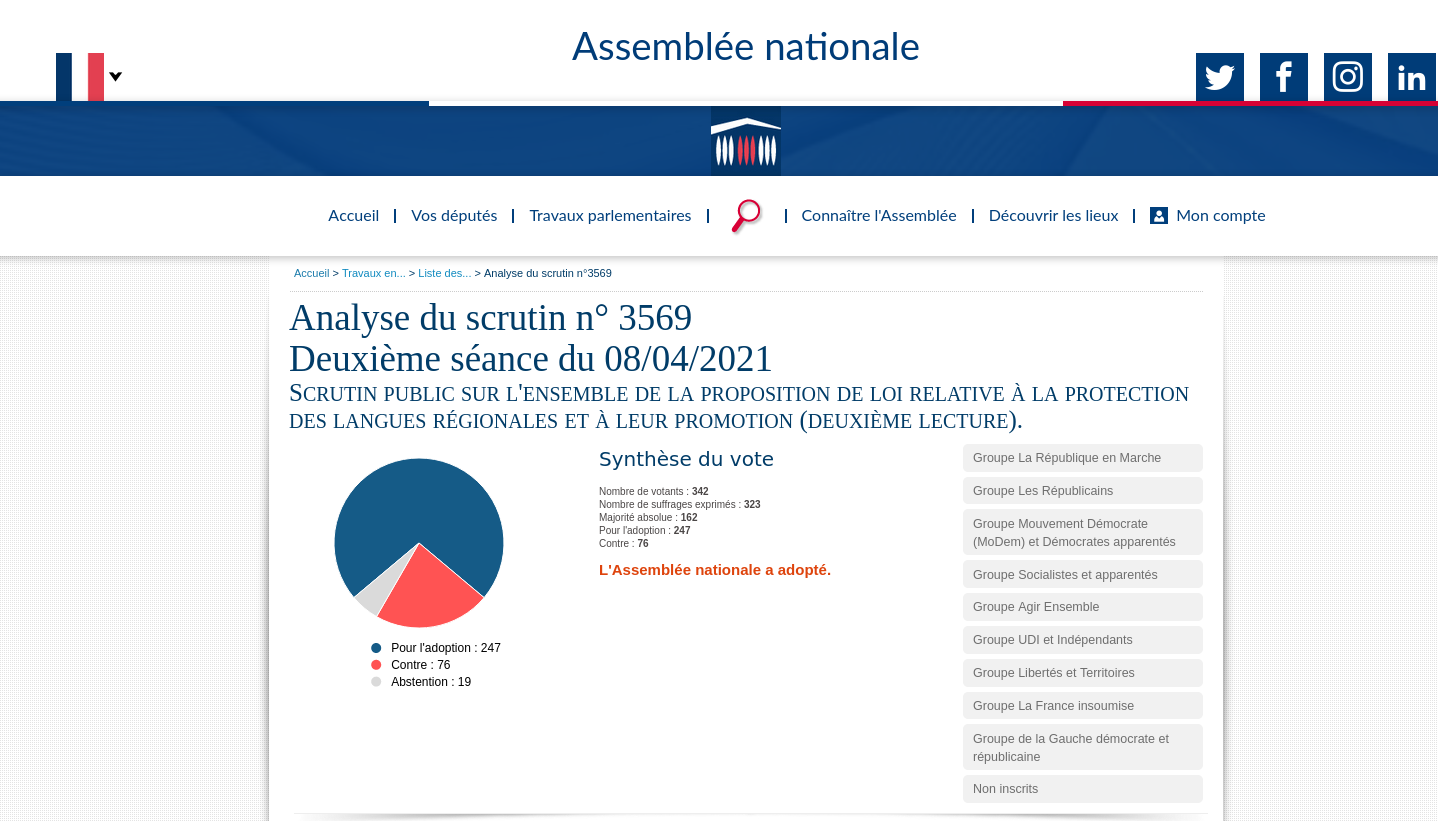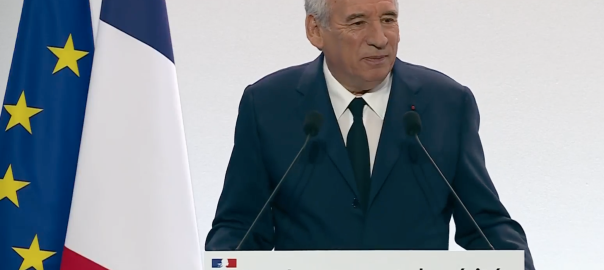L’esquèrra europèa se pòt inspirar de çò que se passa dins l’Estat espanhòl

Lo Partit Occitan se regaudís del resultat obtengut per EH Bildu, la coalicion d’esquèrra sobeiranista en la comunautat autonòma basca d’Euskadi. Aqueste partit a obtengut un nombre de deputats al Parlament d’Euskadi que s’èra pas jamai vist duscas ara. Es al nivèl del Partit Nacionalista Basco que gobèrna, quasi sens trencadura, dempuèi la fin del franquisme.
Es important de remarcar que los partits basques nacionalistas, PNV/EAJ e EH Bildu representan una fòrça granda majoritat dels electors, siá lo 69% dels vòtes.
Remarcam tanben que Vox, los nostalgics del franquisme, arriban pas a s’implantar en Euskadi e progrèssan pas.
Lo Partit Nacionalista Basc seguirà de gobernar en passant un acòrd amb lo Partit Socialista d’Euskadi, representacion basca del partit de Pedro Sanchez.
EH Bildu, demorarà dins l’oposicion mas son resultat confirma, après lo resultat de fa qualques setmanas del BNG l’esquèrra sobeiranista en Galícia (en progression regulara dempuèi sa creacion), que l’Estat espanhòl se pòt pas gobernar sense prendre en consideracion la volontat dels pòbles que defendon lor identitat, lor lenga e lor cultura. Aqueles partits son portaires de projèctes de politicas democraticas, ecologicas, socialas, culturalas e lingüisticas innovantas. Lo quite govèrn central espanhòl pòt pas trobar de majoritat sense aqueles partits. Es lo cas de Pedro Sanchez qu’es obligat, per aver una majoritat, de trobar lo sosten dels partits independentistas e sobeiranistas catalans, basques e galicians.
Saludam lo resultat de EH Bildu obtengut malgrat una dreta e una extrema dreta espanholistas que fan coma se i aviá pas avut dempuèi d’annadas en País Basc una causida clara e definitiva en favor de la patz en anant sonque sul terrenh democratic e electoral per conquistar lo dret a a la sobeiranetat. Lo programa politica de l’esquèrra basca coma lo programa de l’esquèrra galiciana deuriá inspirar fòrça partits en Euròpa a la velha de las eleccions europèas, que siá dins lo domeni de la sobeiranetat energetica, alimentària o dins lo domeni social, educatiu o lingüistic.
Partit occitan lo 29 d’abril de 2024.